C’est à l’INA que j’ai compris ce qu’était vraiment le travail, et comme ce qui reste à venir, et dans un nouveau monde industriel à venir. J’y ai collaboré avec des ingénieurs et développeurs qui travaillaient en logiciel libre, et j’ai découvert là une conception du travail tout à fait différente de ce qu’on enseignait dans les écoles, et à mes yeux proprement révolutionnaire – c’est-à-dire faisant apparaître comme caduque et donc révolue la conception dominante. Je n’ai pas été convaincu immédiatement : il m’a fallu quelques mois et quelques voyages, notamment à Berlin, pour forger ma conviction que le logiciel libre correspondait à un modèle économique non seulement viable, non seulement durable, mais extraordinairement gratifiant pour ceux qui le pratiquaient et qui, bien qu’il s’agisse d’un travail industriel, et parce qu’il est fondé par le développement et le partage des responsabilités et des capacités, ne conduisait pas à la prolétarisation, mais tout au contraire, installait la déprolétarisation au coeur d’une nouvelle logique économique fondée sur la valorisation et le partage des savoirs.
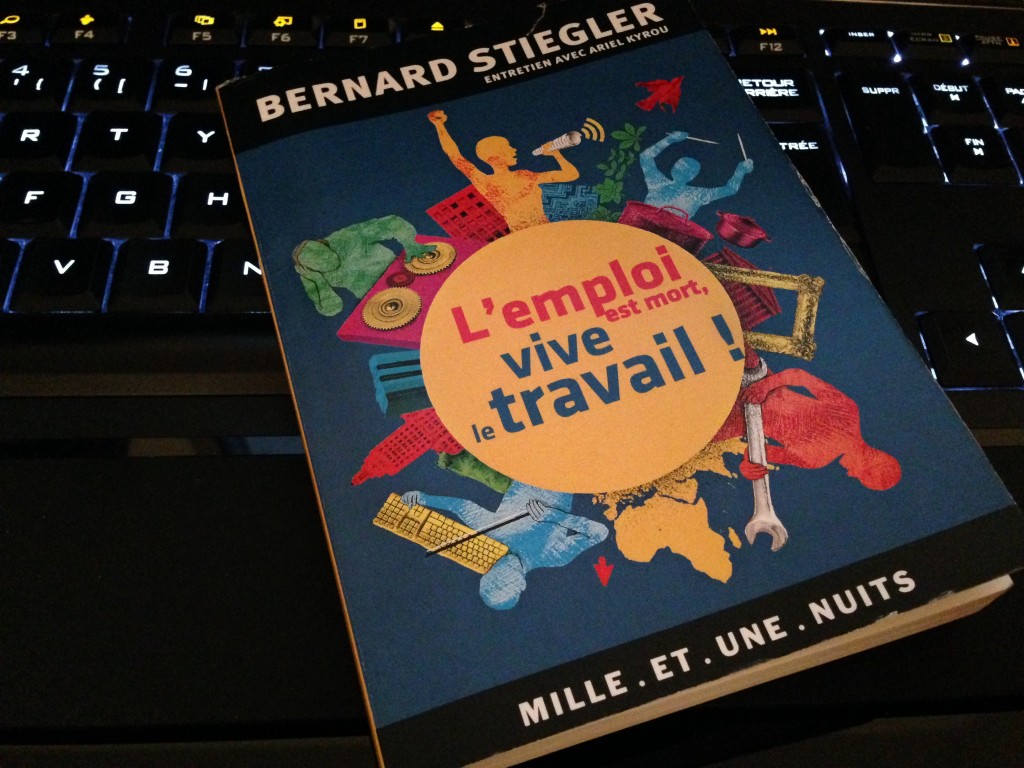
L’emploi est mort, vive le travail ! Bernard Steigler, entretien avec Ariel Kyrou. Mille et une nuits
Dans le logiciel libre, les gens travaillent – et ils ne viennent pas au bureau avant tout pour toucher leur salaire. Ils coopèrent avec d’autres développeurs et alimentent ainsi leurs savoirs en même temps que celui de leurs interlocuteurs. Ils sont spontanément actifs, à l’écoute, en attente de pouvoir faire ce que ce modèle leur inspire, et porteurs en cela d’initiatives sans que personne n’ait à exiger d’eux qu’ils le soient.
Les communautés du logiciel libre exploitent elles aussi les automates, mais elle les mettent au service de leur propre déprolétarisation. C’est pour cela que les développeurs du logiciel libre sont en règle générale très motivés par leur travail. Parce qu’ils produisent du savoir et de l’individuation, ils construisent l’époque industrielle de la déprolétarisation en mettant les automates au service de leur propre désautomatisation. Le libre permet d’améliorer sans cesse le système par cette constante désautomatisation, et de produire quelque chose que les automates n’auraient jamais pu produire, par la coopération de ceux qui les pratiquent. C’est d’abord par l’exploitation de l’automatisme que l’on produit de la désautomatisation – et par là un travail qui ne se résume pas à un emploi.
L’exemple des développeurs de logiciel libre est intéressant et très parlant. Mais qu’en est-il de ceux qui utilisent plutôt qu’ils ne fabriquent des logiciels, des applications ou même des services ?
Autrement dit, la capacité à se saisir de systèmes automatiques, à les « pratiquer » en quelque sorte pour mieux nous « désautomatiser », n’est-elle pas l’apanage d’une minorité d’individus ? De communautés comme celle des développeurs, ayant la maîtrise de ces systèmes automatisés, là où la majorité d’entre nous ne la possède aucunement ? Ou alors, pour ne plus rester de simples prolétaires de l’ère numérique, voués à subir les programmes des autres, faut-il comme le suggère Douglas Rushkoff que tous les écoliers apprennent à coder ?
Extraits des pages 38 à 40 et 64 à 65 de L’emploi est mort, vive le travail – Bernard Steigler, entretien avec Ariel Kyrou au Editions Mille et une nuits.
